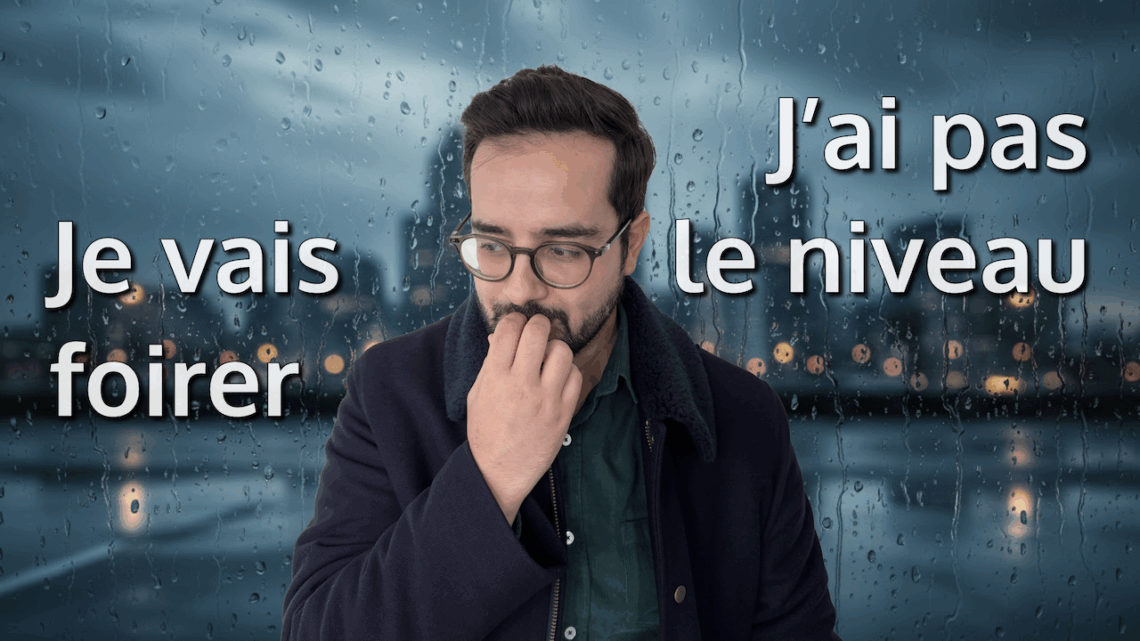Introduction : La panique du quotidien
Le syndrome de l’imposteur désigne une tendance à douter de ses compétences malgré des aptitudes avérées, ce qui entraîne un manque de confiance et une performance réduite (Chen, Wong, Tarrit, & Peruma, 2024). Aussi appelé phénomène de l’imposteur, il décrit le fait de remettre en question ses réussites, même lorsque les preuves montrent le contraire. Les personnes touchées craignent souvent d’être “démasquées” comme des fraudeurs, ce qui peut s’accompagner d’anxiété ou de dépression.
Découvert à la fin des années 1970 par Suzanne Imes et Pauline Clance, il a d’abord été observé chez des femmes brillantes et d’autres groupes marginalisés. Depuis, il est devenu un sujet très étudié, notamment dans les milieux académique et médical. On s’y intéresse particulièrement en médecine, car ce syndrome est lié à d’autres problèmes de santé mentale comme le burnout, l’anxiété et la dépression (Huecker, Shreffler, McKeny & Davis, 2023).
Au-delà de la santé mentale, il a aussi un impact concret dans la vie professionnelle : les personnes concernées se perçoivent comme moins efficaces, moins satisfaites, et ont plus de mal à communiquer, collaborer et rester concentrées. Elles se sentent moins productives, ce qui peut affecter leur bien-être et leur efficacité au travail (Guenes et al., 2024).
Définition
Le syndrome de l’imposteur n’est pas un trouble psychologique reconnu par les classifications médicales, mais plutôt un phénomène psychologique. Il se manifeste par un ensemble de pensées et de dynamiques qui amènent les personnes à attribuer leurs réussites à la chance ou à l’aide des autres, tout en minimisant leurs compétences réelles. En clair, c’est un cercle vicieux : malgré les efforts et les succès, la personne a l’impression de ne jamais être assez compétente (Huecker et al., 2023 ; Al Lawati et al., 2025).
Signes du syndrome de l’imposteur
Le syndrome de l’imposteur ne se réduit pas à un simple manque de confiance en soi. Il est plus fréquent chez les personnes perfectionnistes, celles qui doutent de leurs capacités ou présentent une anxiété marquée (Duncan et al., 2023; Parkman, 2016). Les comportements et attitudes suivants sont souvent observés (Huecker et al., 2023; Bravata, Watts, Keefer, Madhusudhan, Taylor, Clark, Nelson, Cokley, & Hagg, 2020).
Se sentir pris dans un cercle sans fin signifie que certaines personnes se surinvestissent pour être sûres de réussir, tandis que d’autres procrastinent et finissent par tout faire à la dernière minute. Dans les deux cas, même après avoir atteint l’objectif, elles doutent que ce soit grâce à elles, et le doute réapparaît à la tâche suivante.
La quête de perfection correspond au fait de se fixer des attentes irréalistes et de considérer chaque erreur comme une preuve d’incompétence. Se voir comme un “fraudeur” revient à vivre avec la peur constante que les autres finissent par découvrir un manque supposé de compétence. Ne pas croire à ses réussites, c’est attribuer ses succès à la chance ou à l’aide des autres plutôt qu’à ses propres efforts.
La peur d’échouer, mais aussi parfois de réussir, est également fréquente : la première s’explique par la crainte d’être démasqué, la seconde par l’idée que réussir signifierait devoir supporter encore plus de pression.
Travailler en mode “super-héros” désigne l’attitude qui consiste à multiplier les responsabilités et à en faire toujours plus pour prouver sa valeur, souvent au détriment de sa santé mentale.
La dévalorisation se traduit par une tendance à minimiser ses compétences et à refuser de reconnaître ses qualités. La comparaison constante conduit à se sentir systématiquement moins bon que ses collègues ou camarades.
Enfin, il existe aussi des répercussions sur la santé mentale, comme l’anxiété, la dépression ou le burnout (APA, 2021).
En résumé, le syndrome de l’imposteur fonctionne comme un cercle vicieux : malgré les efforts et les réussites, la personne a l’impression de ne jamais être assez compétente (Huecker et al., 2023).
1. Performances académiques et apprentissage
Le syndrome de l’imposteur peut freiner la réussite académique des étudiants en informatique, car il complique des tâches clés comme la compréhension de code, en augmentant le doute et la charge mentale (Chen, Wong, Tarrit, & Peruma, 2024).
Une étude menée auprès d’étudiants en dernière année d’informatique a montré qu’un niveau élevé de syndrome de l’imposteur était corrélé avec un temps plus long d’examen du code et une probabilité plus faible de résoudre correctement le problème (Chen, Wong, Tarrit, & Peruma, 2024).
De plus, une enquête auprès de 209 étudiants en informatique à l’Université de Californie à San Diego a révélé que 57 % souffraient du syndrome de l’imposteur, un taux plus élevé que dans d’autres filières comme la médecine, les soins infirmiers ou la psychologie (Rosenstein et al., 2020).
Chez les étudiants et étudiantes en data science, le phénomène est également courant, souvent à un niveau modéré ou élevé. Plus les étudiants accordent d’importance à leur genre et à la façon dont ils sont perçus comme homme ou femme, plus ils ont tendance à ressentir le syndrome de l’imposteur (Duncan et al., 2023).
2. Différences de genre
Le syndrome de l’imposteur touche davantage les femmes que les hommes dans les métiers du numérique.
- Selon Guenes et al. (2024), 60,6 % des femmes rapportent vivre ce syndrome contre 48,8 % des hommes.
- Une autre étude indique 71 % de femmes concernées, contre 52 % des hommes (Rosenstein et al., 2020).
- Des travaux menés auprès de plus de 600 ingénieurs logiciels dans 26 pays confirment cette tendance : les femmes, dans un secteur encore largement masculin, se sentent davantage jugées, manquent de modèles de référence et subissent une pression accrue pour prouver leur valeur, ce qui accentue le doute (Guenes, Tomaz, Trinkenreich, Baldassarre, Storey, & Kalinowski, 2025).
3. Prévalence et diversité
Globalement, plus de la moitié des ingénieurs logiciels présenteraient des niveaux fréquents à intenses de syndrome de l’imposteur : 52,7 % selon une étude menée auprès de 624 ingénieurs (Guenes, Tomaz, Kalinowski, Baldassarre, & Storey, 2024).
La prévalence varie également selon l’origine ethnique : 67,9 % chez les participants asiatiques, 65,1 % chez les Noirs/Afro-américains, contre 50 % chez les participants blancs (Guenes et al., 2024).
Des facteurs personnels semblent aussi jouer : les personnes mariées avec enfants se disent moins concernées par ce phénomène (Guenes et al., 2024).
4. Bien-être et santé mentale
Le syndrome de l’imposteur n’affecte pas seulement la performance : il impacte aussi la santé mentale.
Une enquête auprès de 224 personnes issues du domaine du logiciel (étudiants en informatique et ingénieurs) a montré que plus le syndrome de l’imposteur était présent, plus l’anxiété et la dépression augmentaient, et plus le sentiment de bonheur diminuait.
À l’inverse, une meilleure connaissance de la santé mentale était associée à moins de syndrome de l’imposteur et à un meilleur bien-être, notamment via une meilleure efficacité perçue et une satisfaction accrue (Takaoka, Jaccheri, & Sharma, 2024).
Les racines du problème (causes possibles)
Le syndrome de l’imposteur naît souvent d’un mélange de facteurs : traits personnels (anxiété, perfectionnisme, estime de soi fragile), histoire familiale (exigence, surprotection), position sociale (se sentir minoritaire), comparaison permanente (réseaux sociaux) et environnements exigeants (académie, entreprise). Aucun facteur ne “condamne” à l’imposteurisme : ce sont des risques, pas des fatalités. Identifier ses déclencheurs personnels aide déjà à reprendre la main (Reid, 2025).
1. La personnalité
L’anxiété et la sensibilité au stress peuvent favoriser le syndrome de l’imposteur : elles amènent à ruminer, à anticiper le pire et à douter après coup, en pensant par exemple « j’ai juste eu de la chance ».
Le perfectionnisme joue également un rôle important, avec des objectifs quasi impossibles, la peur de décevoir et la difficulté à rendre un travail jugé “suffisamment bon”. Deux formes sont courantes : « je dois être parfait·e », qui reflète une exigence personnelle extrême, et « les autres attendent la perfection de moi », qui traduit une pression perçue du regard d’autrui.
Enfin, une faible estime de soi contribue aussi au phénomène : les personnes ont tendance à minimiser leurs compétences et à attribuer leurs succès à la chance, aux collègues ou aux outils (Reid, 2025).
2. L’éducation et le style parental
Une exigence élevée ou incohérente, avec des compliments rares ou conditionnels (« bien… mais tu pouvais faire mieux ») et des critiques variables, peut nourrir le syndrome de l’imposteur. La surprotection et le contrôle limitent les occasions d’apprendre par l’erreur et entretiennent la peur de décevoir. Quand la valeur personnelle semble liée uniquement aux performances, chaque échec devient une menace identitaire. Cela se traduit, par exemple, par l’enfant “toujours premier de classe” qui devient adulte et panique à la moindre remarque, ou par des félicitations centrées sur les notes plutôt que sur l’effort et le processus (Reid, 2025).
3. Se sentir différent·e du groupe
Le syndrome de l’imposteur peut aussi être favorisé par le fait de se sentir différent·e de son entourage. Cela concerne les minorités visibles ou invisibles comme le genre, l’origine, l’âge, le statut socio-économique ou encore la neuroatypie. Dans ces situations, on peut avoir l’impression de ne pas avoir sa place, de représenter tout un groupe ou d’être constamment scruté·e.
Le manque de modèles de référence, c’est-à-dire de personnes qui nous ressemblent dans des postes importants, renforce encore ce sentiment. Concrètement, cela se traduit par une pression à toujours devoir faire ses preuves, la peur d’être catalogué·e, une sur-préparation pour compenser ou encore une tendance à s’auto-censurer en réunion (Reid, 2025).
4. Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle dans le syndrome de l’imposteur. La comparaison est permanente avec ce que chacun montre de meilleur : promotions, conférences ou projets personnels. Ce biais de visibilité renforce l’impression que les autres réussissent toujours mieux, car on voit rarement les coulisses et les échecs.
La conséquence est souvent un sentiment d’être en retard, de manquer de compétences, accompagné d’une augmentation de l’anxiété et du doute (Reid, 2025).
5. Le contexte d’étude ou de travail
Le syndrome de l’imposteur peut aussi être alimenté par certains environnements académiques ou professionnels. Les milieux compétitifs où les évaluations sont fréquentes, comme une thèse, des concours ou des revues de code, créent une pression constante.
Dans certains environnements académiques ou professionnels, les erreurs sont peu tolérées et l’on valorise surtout les personnes qui travaillent plus que les autres, parfois en faisant beaucoup d’heures supplémentaires pour rattraper une situation. Ce type de climat renforce le sentiment d’imposture, d’autant plus que les objectifs changent souvent et paraissent difficiles à atteindre. Les périodes de transition, comme un nouveau poste, une promotion, un retour de congé ou un changement d’équipe ou de technologie, provoquent aussi fréquemment un pic de doute. Enfin, le manque de feedback et de mentorat rend plus compliqué le fait d’évaluer son niveau réel et de se sentir légitime.
Enfin, lorsque les personnes autour de soi partagent toutes un profil assez semblable et qu’il y a peu de diversité visible, ceux qui ne s’y reconnaissent pas peuvent avoir l’impression de ne pas avoir leur place. Dans la pratique, cela peut conduire à éviter de poser des questions, à refuser des opportunités par peur d’échouer, à rester en retrait ou à travailler de manière excessive pour se sentir légitime (Reid, 2025).
Impact sur les métiers dans le domaine de l’informatique
Le syndrome de l’imposteur est largement étudié dans le domaine académique et celui de l’informatique, sans pour autant se limiter à ces secteurs, puisqu’on le retrouve aussi dans les milieux médicaux. Une étude menée auprès d’étudiants en dernière année d’informatique a montré qu’un niveau élevé d’imposteurisme était associé à un temps plus long d’examen du code et à une probabilité plus faible de résoudre correctement un problème (Chen, Wong, Tarrit, & Peruma, 2024).
Les différences de genre apparaissent aussi marquées. Plusieurs recherches montrent que les hommes semblent moins touchés que les femmes (Chen et al., 2024 ; Guenes et al., 2024 ; Parkman, 2016 ; Krause-Levy et al., 2025). Par exemple, l’étude de Guenes et al. (2024) rapporte que 60,6 % des femmes disent vivre le syndrome de l’imposteur, contre 48,8 % des hommes. Une autre enquête montre des taux encore plus élevés : 71 % des femmes contre 52 % des hommes (Rosenstein et al., 2020). Des travaux menés auprès de plus de 600 ingénieurs et ingénieures dans 26 pays confirment cette tendance : les femmes sont plus exposées, notamment parce qu’elles peuvent se sentir davantage jugées, manquer de modèles auxquels s’identifier et subir une pression accrue pour prouver leur valeur, ce qui accentue le doute sur leurs compétences (Guenes, Tomaz, Trinkenreich, Baldassarre, Storey, & Kalinowski, 2025).
L’ampleur du phénomène est également frappante. Une étude a trouvé que plus de la moitié des 624 ingénieurs logiciels interrogés (52,7 %) présentaient des niveaux fréquents à intenses de syndrome de l’imposteur (Guenes, Tomaz, Kalinowski, Baldassarre, & Storey, 2024). Les résultats mettent aussi en évidence des disparités selon l’origine : la prévalence est plus élevée chez les personnes asiatiques (67,9 %) et noires/afro-américaines (65,1 %) que chez les participants blancs (50,0 %) (Guenes et al., 2024). En revanche, être marié avec enfants semble jouer un rôle protecteur (Guenes et al., 2024). Globalement, plus d’un ingénieur logiciel sur deux est concerné, avec des taux particulièrement élevés chez les femmes et les minorités ethniques.
Chez les étudiants en data science, le syndrome de l’imposteur apparaît également fréquent, souvent à un niveau modéré ou élevé. Plus ces étudiants accordent de l’importance à leur genre et à la façon dont ils sont perçus comme homme ou femme, plus ils rapportent des expériences d’imposteur (Duncan et al., 2023). Une autre recherche menée auprès de 209 étudiants en informatique de l’Université de Californie à San Diego a montré que 57 % d’entre eux souffraient du syndrome de l’imposteur, un taux plus élevé que celui observé dans d’autres filières étudiantes comme la médecine, les soins infirmiers ou la psychologie (Rosenstein et al., 2020).
Enfin, les effets psychologiques associés sont notables. Une étude auprès de 224 personnes du domaine logiciel, incluant étudiants et ingénieurs, montre que plus le syndrome de l’imposteur est élevé, plus l’anxiété et la dépression augmentent et plus le sentiment de bonheur diminue. À l’inverse, une meilleure connaissance de la santé mentale est associée à moins de syndrome de l’imposteur et à un meilleur bien-être. Ce bien-être est également lié au sentiment d’efficacité personnelle et à la satisfaction générale (Takaoka, Jaccheri, & Sharma, 2024).
Prévenir plutôt que guérir
Même si le syndrome de l’imposteur est fréquent, des recherches récentes montrent qu’il existe des moyens concrets de réduire les risques d’y tomber. Par exemple, plusieurs études soulignent que les exercices de gratitude, comme le fait d’écrire chaque jour trois choses positives vécues dans sa vie professionnelle ou personnelle, aident à améliorer le bien-être et à diminuer l’anxiété ou la dépression, qui sont souvent liées au sentiment d’imposteur (Diniz et al., 2023).
D’autres travaux mettent en avant l’intérêt d’approches éducatives et de sensibilisation intégrées dans la formation, comme les ateliers de groupe, le mentorat et la supervision bienveillante. Ces dispositifs permettent de reconnaître et de normaliser le phénomène avant qu’il ne s’installe trop profondément (Siddiqui, 2024).
Dans le domaine de la santé, une étude expérimentale a montré que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) peut renforcer l’estime de soi et aider les étudiants à mieux gérer leurs pensées d’auto-dévalorisation liées à l’imposteur (Sheykhangafshe et al., 2024).
Enfin, une revue récente des interventions disponibles insiste sur l’importance de créer un environnement de soutien. Un feedback constructif, un climat inclusif et la valorisation des réussites individuelles apparaissent comme des facteurs protecteurs essentiels (Para et al., 2024). Cela dit, travailler sur la gratitude, l’estime de soi, le soutien éducatif et la bienveillance dans les milieux académiques et professionnels peut vraiment aider à prévenir l’installation du syndrome de l’imposteur.
Gérer le syndrome de l’imposteur
Chacun vit le syndrome de l’imposteur à sa manière, et les solutions dépendent de l’impact qu’il a sur le quotidien. Lorsque le syndrome de l’imposteur prend trop de place au quotidien, consulter un psychologue ou un professionnel de la santé mentale peut être une étape précieuse : ne pas hésiter à demander de l’aide fait déjà partie du chemin.
Parmi les approches possibles :
- Parler à un professionnel : consultation psychologique, psychothérapie (p. ex. thérapie cognitivo-comportementale).
- Prendre soin de sa santé mentale : pratiquer des exercices de gratitude, réfléchir à ses réussites, utiliser des techniques de gestion du stress.
- Dans certains cas : recourir à un traitement médicamenteux, surtout si d’autres troubles comme l’anxiété ou la dépression sont associés.
Gérer le syndrome de l’imposteur, c’est aussi reconnaître qu’il peut s’accompagner d’anxiété, de dépression, de burnout ou d’une faible estime de soi, et qu’il est donc important de prendre en compte ces difficultés associées (Huecker, Shreffler, McKeny & Davis, 2023).
Même si ce sentiment peut sembler difficile à surmonter, diverses stratégies peuvent contribuer à en réduire les effets progressivement:
1. Revoir sa vision de la compétence
Même si ce sentiment peut sembler difficile à surmonter, diverses stratégies peuvent contribuer à en réduire les effets progressivement. Beaucoup de personnes touchées pensent qu’être compétent·e veut dire ne jamais se tromper, tout savoir et réussir du premier coup. En réalité, c’est l’inverse : apprendre, se tromper et demander de l’aide font partie du processus normal.
Accepter l’imperfection est une étape essentielle, car le perfectionnisme est un piège. Il est parfois plus sain de rendre un travail “suffisamment bon” que de bloquer en attendant un résultat parfait. On peut aussi s’autoriser de petites imperfections, comme arriver quelques minutes en retard ou laisser son bureau en désordre.
Il est aussi utile d’apprendre à être débutant. La maîtrise vient avec la pratique, et s’essayer à un nouveau hobby (cuisine, peinture, sport, jeu vidéo) permet d’intégrer que l’échec fait partie de l’apprentissage.
Demander de l’aide sans honte est une autre clé. Poser des questions est un signe de maturité, pas de faiblesse. On peut même se fixer comme objectif de demander une ou deux précisions par jour à un collègue ou mentor. Enfin, apprendre à déléguer et à dire non permet de ne pas tout porter seul·e et de réduire la pression.
2. S’approprier ses réussites
Les personnes qui vivent le syndrome de l’imposteur ont tendance à attribuer leurs succès à la chance, aux autres ou au contexte. Pour casser ce réflexe, il faut prendre conscience de son rôle réel.
Faire la liste de ses accomplissements aide à garder une trace de ses succès : diplômes, promotions, projets réussis, mais aussi petites victoires comme une présentation bien menée ou un collègue aidé. Attribuer du crédit à soi-même est essentiel : pour chaque réussite, il est utile de distinguer les facteurs externes (par exemple une recommandation) et ses propres efforts (préparation, compétences, implication).
Apprendre à accepter les compliments est aussi une étape clé. Au lieu de répondre “oh ce n’était rien”, il suffit de dire “merci”, afin de laisser son esprit intégrer la reconnaissance. Célébrer les petites étapes renforce également l’estime de soi : une pause, une promenade ou un moment détente après une tâche accomplie contribuent à ancrer une image positive de ses efforts. Enfin, garder des traces visibles de ses réussites (dossier, tableau d’affichage, mails positifs, certificats) permet d’avoir des repères concrets dans les moments de doute.
3. Repenser la comparaison avec les autres
La comparaison constante est une source majeure du syndrome de l’imposteur : se croire moins intelligent·e, moins rapide ou moins “doué·e” que les autres entretient le cercle vicieux. Parler de ses doutes avec un mentor, un proche ou un thérapeute aide à relativiser. Souvent, on découvre que d’autres traversent les mêmes difficultés. Chercher les parcours réels de personnes admirées permet aussi de voir que même les plus brillants ont connu des échecs, des hésitations et parfois de la chance. Il est important de bien choisir à qui partager ses doutes. Éviter les personnes en concurrence directe limite les risques de nourrir la comparaison. Un cercle bienveillant ou extérieur est préférable.
Limiter l’impact des réseaux sociaux est aussi utile : ces plateformes mettent surtout en avant les réussites et rarement les coulisses. Réduire son temps en ligne, désactiver les notifications et réserver des moments sans écran aide à prendre du recul. Enfin, privilégier des activités hors ligne (sport, loisirs, rencontres) permet de renforcer l’estime de soi et de sortir du cycle de la comparaison virtuelle.
Conclusion
Le syndrome de l’imposteur ne s’efface pas du jour au lendemain, mais il peut s’alléger avec le temps. En reconnaissant ses compétences et en limitant les comparaisons, il devient possible de se sentir plus à sa place.
Références
American Psychological Association. (2021). How to overcome impostor phenomenon. APA Monitor on Psychology. https://www.apa.org/monitor/2021/06/cover-impostor-phenomenon
Bravata, D. M., Watts, S. A., Keefer, A. L., Madhusudhan, D. K., Taylor, K. T., Clark, D. M., Nelson, R. S., Cokley, K. O., & Hagg, H. K. (2020). Prevalence, predictors, and treatment of impostor syndrome: A systematic review. Journal of General Internal Medicine, 35(4), 1252–1275. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05364-1
Chen, A., Wong, C., Tarrit, K., & Peruma, A. (2024). Impostor syndrome in final year computer science students: An eye tracking and biometrics study. In Lecture Notes in Computer Science: Augmented Cognition (Vol. 14694, pp. 22–41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61569-6_2
Diniz, G., Faria, L., & Cardoso, A. (2023). The effects of gratitude interventions: A systematic review. Frontiers in Psychology, 14, 1223456. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1223456
Duncan, L., Taasoobshirazi, G., Vaudreuil, A., Kota, J. S., & Sneha, S. (2023). An evaluation of impostor phenomenon in data science students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(5), 4115. https://doi.org/10.3390/ijerph20054115
Guenes, P. (2025). Decoding the impostor phenomenon: Unveiling factors and mitigation strategies for software professionals. In 47th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSE-Companion66252.2025.00052
Guenes, P., Tomaz, R., Kalinowski, M., Baldassarre, M. T., & Storey, M.-A. (2024, April). Impostor phenomenon in software engineers. In Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Society Track (ICSE-SEIS 2024). ACM. https://doi.org/10.1145/3639475.3640114
Guenes, P., Tomaz, R., Trinkenreich, B., Baldassarre, M. T., Storey, M.-A., & Kalinowski, M. (2025). Impostor phenomenon among software engineers: Investigating gender differences and well-being. In IEEE/ACM Sixth Workshop on Gender Equality, Diversity, and Inclusion in Software Engineering (GEICSE). IEEE. https://doi.org/10.1109/GEICSE66911.2025.00009
Huecker, M. R., Shreffler, J., McKeny, P. T., & Davis, D. (2023, July 31). Imposter phenomenon. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK585058/
Krause-Levy, S., Petersen, A., Campbell, O. O., Griswold, W. G., et al. (2025, July). Multi-institutional study on impostor phenomenon. ACM Transactions on Computing Education. https://doi.org/10.1145/3748665
Para, E., et al. (2024). Interventions addressing the impostor phenomenon: A review of recent strategies. Frontiers in Psychology, 15, 1098765. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1098765
Parkman, A. (2016). The impostor phenomenon in higher education: Incidence and impact. Journal of Higher Education Theory and Practice, 16(1), 51–60.
Reid, S. (2025, August 15). Imposter syndrome: Causes, types, and coping tips. HelpGuide.org.https://www.helpguide.org/mental-health/wellbeing/imposter-syndrome-causes-types-and-coping-tips
Rosenstein, A., Raghu, A., & Porter, L. (2020, March). Identifying the prevalence of the impostor phenomenon among computer science students. In Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE ’20) (pp. 30–36). ACM. https://doi.org/10.1145/3328778.3366815
Sheridan Center for Teaching and Learning. (2023). Impostor phenomenon in the classroom. Brown University. https://sheridan.brown.edu/resources/inclusive-anti-racist-teaching/inclusive-teaching/impostor-phenomenon-classroom
Sheykhangafshe, F., Nouri, E., Savabi Niri, V., Choubtashani, M., & Farahani, A. (2024). The efficacy of cognitive behavioral therapy on mental health, self-esteem and emotion regulation of medical students with impostor syndrome. Educational Research in Medical Sciences, 13(1), e147868. https://doi.org/10.5812/ermsj-147868
Siddiqui, Z. K. (2024). Educational interventions for impostor phenomenon in high-achieving women. BMC Medical Education, 24, 49. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04984-w
Takaoka, A. J. W., Jaccheri, L., & Sharma, K. (2024). Exploring self-care, anxiety, depression, and the gender gap in the software engineering pipeline. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21(11), 1468. https://doi.org/10.3390/ijerph21111468